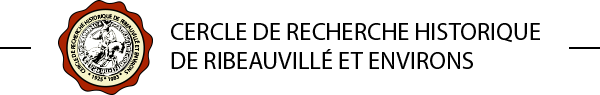~ 2e trimestre 2024~
Le Landgraben (littéralement « fossé provincial ») sépare, depuis des temps immémoriaux, le Nordgau et le Sundgau (le Bas-Rhin du Haut-Rhin). Il correspond à un secteur déprimé de la plaine d’Alsace et s’étend des collines sous-vosgiennes jusqu’au Rhin : territoire marécageux, inhospitalier, assez étendu. C’est le grand Ried situé entre Sélestat et Illhaeusern. Il suit le cours du Eckenbach qui prend sa source au Taennchel et qui passe par Bergheim, Guémar et Illhaeusern.
Dès le néolithique ce territoire marque une frontière entre différents peuples :
- durant la période celtique de la Tène (ou second âge du fer – apparaît au Ve siècle av. J.-C.) il sépare les Médiomatriques (peuple gaulois de la Gaule Belgique. Leur territoire correspond, à l’origine, aux diocèses médiévaux de Verdun, Metz, Strasbourg, Spire et peut-être celui de Worms) au nord des Séquanes au sud (peuple gaulois établi en actuelle Franche-Comté sur le versant ouest du massif du Jura).
- pendant la période romaine on trouve les Triboques (Peuple germanique - même si certains auteurs pensent qu’ils étaient celtes - qui occupait la plaine d’Alsace et l’Ortenau) et les Rauraques (peuple celte originellement établi dans la Ruhr).
Les Romains conservent d’ailleurs les limites du Landgraben pour séparer la province de Germania prima (du Rhin supérieur jusqu’à la plaine d’Alsace) au nord de celle de Maxima Sequanorum (s’étend sur le massif du Jura, le Plateau suisse et la plaine d'Alsace) au sud.
A l’époque carolingienne on crée deux comtés (Gauen), le Nordgau et le Sundgau qui reprennent les limites du Landgraben.
Au Moyen-Age, le christianisme garde ces limites en instituant les évêchés de Strasbourg au nord et l’évêché de Bâle au sud.
En 1125, l’empereur Lothaire II crée la fonction de Landgraf (comte provincial). Dans le Nordgau, c’est le plus souvent l’évêque qui assume cette fonction. Dans le Sundgau c’est un membre de la haute noblesse qui est désigné par l’empereur pour veiller aux intérêts du souverain, superviser le fonctionnement de la justice et veiller à la paix publique.
Dans le Sundgau, la Régence est installée à Ensisheim. Les Ribeaupierre exercent à maintes reprises cette mission.
Lors de la Révolution, les autorités créent deux départements alsaciens, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, ayant pour frontière l’ancien Landgraben.
Avec les travaux de drainage du Ried, au fil des siècles, le Landgraben se détecte de moins en moins.
Bibliographie :
- Article de Benoit Jordan paru dans la Revue d’Alsace, n° 149
La bourgeoisie - die Bürger
A l’origine, dès le 13ème siècle, le Bürger est l’habitant d’un bourg ou d’une ville. Mais tout habitant d’un bourg ou d’une ville n’est pas Bürger.
Dans les villes le bourgeois est celui qui possède une maison dans la ville et paye une cotisation spécifique appelée « droit de bourgeoisie ».
La bourgeoisie des villes occupe des charges diverses (juge, greffier, notaire…) ou des métiers rémunérateurs (artisans, commerçants, apothicaires, vignerons…) ; ils vivent dans une certaine opulence. C’est en quelque sorte une élite urbaine qui accapare le pouvoir économique et politique de la cité.
Mais la bourgeoisie n’est pas seulement l’apanage des villes. On trouve également des bourgeois dans les seigneuries. La différence réside dans le fait que le bourgeois doit prêter serment de fidélité au seigneur (Bürger-Eid) et non au Conseil de la Ville.
Dans la seigneurie des Ribeaupierre :
- le bourgeois doit jurer fidélité et obéissance à la seigneurie ;
- il s’engage à rester bourgeois pendant au moins cinq ans et payer pendant ce temps les tailles et autres taxes qui lui sont imposées ;
- il doit posséder un seau d’incendie pour lutter à l’intérieur de l’enceinte de la ville contre le feu ;
- lorsqu’il veut quitter la seigneurie, il doit faire une demande écrite à la seigneurie et à la ville et faire publier sa demande à l’église. Il doit déclarer qu’il n’a pas de dettes envers qui que ce soit. S’il quitte la seigneurie avant cinq ans, il payera les tailles pour ces cinq ans ;
- aucun étranger relevant d’une autre seigneurie ne peut être admis comme bourgeois d’une ville s’il a encore des obligations à remplir qui pourraient soulever des difficultés ou des inconvénients dans son nouveau lieu de résidence.
Pour être admis dans la bourgeoisie il faut :
- être fils de bourgeois déjà résidant dans la commune (Bürgersöhne);
- justifier de sa liberté personnelle c’est-à-dire être agréé par le seigneur territorial, mais aussi par la communauté ;
- posséder un minimum de fortune.
Mais on peut également accéder à la bourgeoisie en épousant la veuve ou la fille d’un bourgeois.
Les textes évoquent deux catégories de bourgeois, les Bürger et les Üsburger. On trouve des bourgeois dans les principales villes de la seigneurie, mais également dans les petites communautés rurales.
Dans la seigneurie des Ribeaupierre, le droit de bourgeoisie se monte à 33 livres et 3 livres au titre du seau d’incendie. Par contre les Judenbürger (bourgeois juifs) payent un droit plus élevé que les bourgeois chrétiens. La raison invoquée est qu’ils ne participaient pas à toutes les missions civiques dévolues aux autres bourgeois.
Le bourgeois peut jouir de droits civils et politiques et peut participer activement à la vie politique et économique de la cité. Juridiquement, il bénéficie de la protection de la seigneurie et ne peut être poursuivi en justice que dans la seigneurie de son ressort .
Mais son statut l’engage aussi à certains devoirs :
- prêter serment d’obéissance au seigneur, renouvelé chaque année lors du Schwörtag (jour du serment) ;
- s’acquitter d’impôts directs (Stallgeld) et indirects (Ungeld) ;
- participer à la sécurité civile de la ville (service de guet, milice …).
En ville, les « non-bourgeois » sont souvent désignés sous le terme Hintersassen ou Schirmer (manant).
En fait, le droit de bourgeoisie lie la seigneurie (la ville) aux hommes qui lui sont utiles pour se développer économiquement et/ou assurer sa sécurité.
Les impôts et autres taxes au Moyen-Age
Sous l’Ancien Régime, les impôts sont très nombreux et très divers. Progressivement les revenus des seigneurs sur leurs terres se diversifient et se complexifient.
Les censiers (registres sur lesquels sont inscrites les contributions du cens, redevances, taxes et impôts divers) évoquent les contributions et les taxes indirectes :
- Gewerf ou Bede, appelé plus tard taille, payé soit en argent, soit en nature. C’est un impôt sur la production agricole ; on parle de Bethkorn (taxe sur le grain), de Bethweizen (taxe sur l’orge), de Weingewerf (taxe sur le vin)… Cela représente, pour Ribeauvillé, une somme de 1138 florins en Son montant n’est pas fixe, le seigneur le calcule en fonction des récoltes et de ses besoins. Cette taxe doit être payée chaque année en trois termes : à la Saint-Hilaire (13 janvier), à la Saint-Jacques (25 juillet) et à la Saint-Martin (le 11 novembre) ;
- Zins ou Güeth: taxe foncière redevable par les paysans qui exploitent les terres appartenant au seigneur, peut être payé en nature ou en monnaie. On l’appelle le Cens, Güeth, quand elle consiste en denrées (grains, vins...) et Zins quand elle est acquittée en argent. Dans la plupart des villages il y a une ferme ou une maison seigneuriale appelée Meyerhof où l’on entrepose les parts de récoltes ainsi levées ;
- Gulten: taxe foncière sur le bâti ;
- Gerichte und Frevelgeld: droits de justice et amendes de toutes sortes (ébriété, atteinte aux bonnes mœurs, non-respect des règles du ban, vente de produits avariés, coups et blessures, … !). Les règlements de police mentionnent la somme des amendes pour chaque type d’infraction. De même, lorsqu’une personne est bannie de la seigneurie, tous ses biens sont saisis et affectés au châtelain ;
- Zoll und Buchse: péages et les droits de passage. A Ribeauvillé, le seigneur touche l’octroi de la porte basse (la plus rentable), tandis que la ville touche l’octroi de la porte haute. Mais, en contrepartie, la ville est chargée de l’entretien du chemin vers Sainte-Marie-aux-Mines ;
- Umgelt ou droit d’accise : taxe sur l’importation et la vente des denrées (la T.V.A. avant l’heure !) ;
- Bannwein ou banvin : tous les cabarets et auberges de la seigneurie sont obligés de vendre, durant 40 jours par an, exclusivement du vin provenant de la cave seigneuriale, au prix fixé par la seigneurie. A la veille de la Révolution les auberges doivent débiter deux foudres de vin à Ribeauvillé (environ 2200 litres) ;
- gabelle: taxe sur le commerce du sel, denrée indispensable à la conservation des aliments et chère jusqu’à la Révolution. Le Salzdebit est la faculté du seigneur de pouvoir acheter le sel où bon lui semble et de le faire vendre ou débiter aux habitants, augmenté d’une taxe conséquente. Les Ribeaupierre importent du sel de Lorraine, mais possèdent, en propre, des salines dans le Jura. Au XVIIIe siècle, les seigneurs délèguent la taxe sur le sel à la ville. C’est là une des ressources principales de la commune qui rapporte annuellement 420 livres. Une anecdote, datée de 1720, mentionne qu’un bourgeois de Ribeauvillé achète du sel à Ammerschwihr, au détriment du magasin de la ville = amende de 6 livres et publication de la sentence par les sergents de ville dans chaque quartier ;
- droits banaux: taxes liées au monopole du four (Ofengeld), du moulin (Mühlzoll) et du pressoir (Trottweingeld). La redevance est de l’ordre du 1/20e du produit cuit, moulu ou pressé ;
- droits liés à l’usage et à l’exploitation forestière, le Rantzgeld;
- Zunftgeld payé par les diverses corporations, dont les ménétriers ;
- taxes sur les ventes de meubles et d’immeubles. Le seigneur perçoit le « soixantième denier » de toutes les ventes qui se font dans la seigneurie ;
- Frongeld: chaque habitant est tenu de donner deux à cinq jours de travail gratuit à la seigneurie par an. Au milieu du XVIIIe siècle, la corvée passe à 10 jours ! Mais les corvées sont « rachetables » selon un tarif en vigueur. (10 sols par jour au début du XVIIIe). Ce sont des journées de travail destinées à la collectivité (entretien des routes, des remparts, des fossés …) ou directement au seigneur (charriage de bois pour le château, labourage des biens seigneuriaux, entretien des Herrschaftsreben (vignes du seigneur). Dans les villes seigneuriales comme Ribeauvillé, les bourgeois doivent fournir chaque jour deux hommes de garde pour le château ;
- droits liés à l’usage des eaux courantes et dormantes, le Fischgeld;
- recettes liées aux terres dont ils ont la jouissance en tant que propriétaires (en quelque sorte une taxe sur le revenu des domaines). Les seigneurs possédaient en propre de nombreux domaines agricoles et viticoles gérés directement par la seigneurie ou confiés à des métayers ;
- droits de succession en cas de décès du chef de famille appelés droits de mainmorte ou Todgeld. La tradition veut que l’on prélève un Fall à quatre pattes (un animal) ou à quatre Stollen (chaise, lit, table) ou à défaut divers effets vestimentaires ;
- Einzuggeld ou Schirmgeld: droits sur les étrangers qui désirent s’installer ou résider dans la seigneurie. Ce droit était fixé à 40 livres au début du XVIIIe siècle ;
- Abzuggeld(droit de détraction) : taxe d’émigration lorsqu’un sujet quitte définitivement la seigneurie pour s’installer ailleurs, ou pour les étrangers qui héritent d’habitants de la seigneurie. Il s’élève au 1/10e des biens ;
- Copulationszetel : droit de mariage pour les futurs époux protestants. A la veille de la Révolution il est fixé à 2 livres ;
- Judengeld: taxe spécifique sur les juifs (12 livres par an par famille au début du XVIIIe siècle) ;
- Fastnachthuhn ou droit de gelinage qui est la redevance d’une poule ou d’un chapon due par fermier à la mi-carême ;
- Standgeld ou droit d’étalage : taxe payée par tout marchand local ou étranger pour installer son étal les jours de foire ;
- Grabengeld: taxe due par les bourgeois pour l’entretien des remparts ;
- Allmendzins: taxe d’usage des communaux ;
- on trouve même trace d’une taxe nommée Frauenpfennig ou Unzuchtgeld qui est un impôt spécifique pour les prostituées !
Thomas Murner (1475-1537) caricature ces taxes en ces termes : Dès qu’une poule a pondu un œuf, le seigneur prend le jaune d’œuf, la gracieuse dame le blanc d’œuf, de sorte qu’il ne reste au paysan que la coquille !
A ces impôts prélevés par le seigneur, il faut ajouter les impôts exigés par l’église et par le souverain.
En ce qui concerne la taxe due au clergé, la plus connue est la dîme ou Zehnte payable au clergé dès le VIIIe siècle ; elle perdure jusqu’à la Révolution. Donner sa dîme est d’abord un devoir moral, mais devient très vite une charge pérenne. Le clergé pour subvenir à ses besoins dispose de biens propres (maisons, champs, forêts, rentes, deniers du culte …) et des perceptions en nature ou argent comptant dont la dîme. Cette taxe est perçue sur les produits de la terre que « Dieu aide à pousser ». On distinguait la Grosszehend (grosse dîme) appliquée sur les céréales, le vin et le foin et la Kleinzehend (petite dîme) prélevée sur les fruits et légumes. A l’origine la dîme était répartie en trois parties :
- un tiers pour l’entretien de l’église paroissiale ;
- un tiers pour la subsistance des desservants de l’église ;
- un tiers pour nourrir les pauvres de la communauté.
Mais au fil du temps, le haut clergé accapare la plus grande partie de cet impôt, ne laissant au bas clergé que des miettes…
Tous ces revenus sont comptabilisés par bailliage. Chaque bailliage assure un certain nombre de dépenses propres à son district (entretien des bâtiments et des voiries, salaires des personnels, frais de l’administration …). Le reste de la collecte des impôts va dans les caisses de la seigneurie.
Chaque bailliage dispose d’une certaine autonomie administrative. Mais chaque année les baillis doivent présenter leurs comptes au seigneur. Le collecteur des impôts dans chaque baillage s’appelle le Gewerfsammler ou Heimburger, charge assurée, jusqu’au XVIIIe siècle, par un fonctionnaire seigneurial proposé par le bailli et agréé par le seigneur. Cette charge, ensuite, est attribuée à un fermier fiscal qui achète, par adjudication, l’office pour trois ans. Ce fermier fiscal collecte tous les impôts (pour le roi, le seigneur, l’église et la communauté) et les redistribue à qui de droit. Mais souvent ces « fermiers du fisc » se débrouillent pour se constituer un bonus substantiel aux dépens des ayants droit. Ce sera le cas du sieur Radius à Ribeauvillé, honni de la population locale à la veille de la Révolution.
Les cahiers de doléances du secteur de Ribeauvillé vont demander expressément l’abolition de ce système, ce qui sera fait par l’Assemblée Constituante de 1789.
~ 1er trimestre 2024~
Le départ d’Henri Bernard
Encore une figure marquante de Ribeauvillé qui disparait.
Qui d’entre nous - jeunes et moins jeunes – en entendant ou en lisant son nom ne revoit pas la silhouette d’Henri, drapé dans sa pélerine blanche et bleue, coiffé de son bicorne et arborant fièrement l’emblème du messager médiéval des Ribeaupierre ? Mais, surtout, il laisse à tous le souvenir d’un homme au visage souriant, d’un contact chaleureux, affable et serviable. Il restera, soyons-en certains, l’image même de Ribeauvillé dont il préside pendant de longues années toutes les cérémonies et festivités.
Mais qui était cet homme tranquille ? Il naît en 1938, à l’orée d’un conflit qui a profondément marqué le monde entier ; peut-être faut-il y voir la source de sa profonde humanité qu’il savait, avec discrétion, répandre autour de lui.
Henri est issu d’une longue lignée de serviteurs de la ville dont il était particulièrement fier :
- le frère de son bisaïeul, Joseph Jean Baptiste, était déjà employé au bureau d’enregistrement (1864), receveur communal (de 1875 à 1889) et administrateur de l’hôpital (1903) ;
- son bisaïeul, Léon, ayant rempli ses obligations militaires en 1870, fut garde-champêtre-chef (en 1879,1880), employé communal (Gemeindediener - de 1882 à 1902) et appariteur (en 1881) ; fonction qui lui permettait de porter, pour les cérémonies, l’uniforme des Weibel des cantons suisses (Ribeauvillé ayant été de 1000 à 1648 vignoble des évêques de Bâle, la Ville de Bâle a offert cet uniforme de Weibel aux couleurs du Prince Max, roi de Bavière sous Napoléon), le bicorne « empire ›› ainsi que la canne d’huissier du conseil municipal.
Concierge de la mairie, il publiait les ordonnances et les nouvelles au son du tambour, ceci particulièrement le dimanche. Aux grandes fêtes de l’année (Fête-Dieu, Pfifferdaj et le 27 janvier, anniversaire de l'empereur d’Allemagne), il devait assurer les salves de tir au mortier, au calvaire près de la Porte des Pucelles (Staffalas-Böhlerschiessen). N’étant pas employé à plein temps il exerçait la profession de vigneron. Il demeurait alors rue des Prêtres ;
- son aïeul, Joseph Henri (le 1er « Henri » de la dynastie), a suivi les traces familiales comme employé communal (Gemeindediener - de 1910 à 1914), employé de la ville (Stadtdiener - en 1916,1918) et appariteur (de 1920 à 1934). Sa fonction l’amena à « rouler son tambour » pour annoncer la mobilisation en 1914, accueillir le rois Louis III de Bavière en 1915, le Général Gouraud (en 1918), prendre part au défilé des troupes françaises le 18 novembre 1918, recevoir le Président Raymond Poincaré, l’Abbé Wetterlé et Hansi. Pour des raisons de santé, il va laisser sa place d’appariteur à son fils Henri ;
- son père, Marie Joseph Henri, reprend donc les fonctions d’appariteur de la ville en 1934, après son service militaire dans la marine et le décès de ses deux parents. Mobilisé dans la marine à la déclaration de guerre, il rentra fin septembre 1940 mai, comme tant d’autres Alsaciens, il fut incorporé de force dans la marine allemande et revint à Ribeauvillé le 3 décembre 1944. Il décèdera en 1986 après avoir présidé nombre de cérémonies, festivités et autres réjouissances. Le 22 février 1986, Henri Bernhard est décédé.
-
- Henri Marie Joseph - celui que l’on a connu – reprit le flambeau familial en 1986. Né à Colmar le 27 juin 1938, il effectue son service militaire (du 12 septembre 1957 au 05 janvier 1960) dans la marine (comme son père) où il navigue sur l’escorteur d’escadre Chevalier Paul en Méditerranée. Il en a d’ailleurs réalisé une maquette à l’échelle 1/100, soit 1,26 m (à part les chaînes d’ancres, il a tout façonné lui-même).
Cette réalisation n’est qu’un exemple de son hobby de maquettiste, citons notamment : le Saint-Ulrich, le Giersberg et le Haut-Ribeaupierre en l’état actuel et en reconstitution du XVe et XVIIe siècles (exposés à la Mairie), une demi-douzaine de petites maquettes de l’église de Hunawihr telle qu’elle était au Moyen-Age et de ses agrandissements successifs, ainsi qu’une autre grande maquette de l’église actuelle avec ses remparts, ses deux cimetières, intérieur et extérieur, les vignes alentour (tout y est, rien ne manque : toutes les tombes, tous les rangs de vignes, tous les ceps), la maquette de la basse ville et de la vieille ville visible au Cercle de Recherche (maquette que Raymond Seiller a entrepris de compléter).
Après son service militaire, Henri fut électricien-installateur à Colmar, agent technique chez Timken-France de 1961 à 1964, année de son entrée à la S.N.C.F. qu’il quitte en 1986 pour rejoindre la Mairie de Ribeauvillé. Suivant la tradition familiale en tant qu’appariteur, il va « servir » sous cinq maires.
En 1990, il prendra le titre de guide messager de la ville de Ribeauvillé. Combien de Ribeauvillois, d’Alsaciens et de touristes ont-ils pu découvrir notre cité grâce à ses commentaires historiques et anecdotes qui émaillaient ses commentaires ? Il savait « faire passer » son amour de Ribeauvillé à ses auditeurs qui repartaient conquis par notre cité et étonnés de son histoire.
Mais, au fait, c’est quoi un appariteur ? Au début du XIXe siècle, l’appariteur ou messager assure la transmission correcte et efficace de l’information ainsi que des messages et annonces officielles. C’est une des personnalités de la ville, en bon rang après le maire, le curé, l'instituteur et les conseillers municipaux. Cette charge de porte-parole et de lien entre la Municipalité les habitants se complète par la mission de présider à toutes les manifestations de la ville.Voilà, une grande page se tourne, le livre s’est refermé, la visite est terminée. Mais nous n’oublierons jamais Henri Bernhard, figure marquante de la cité des Ménétriers. Merci les Bernhard de ce que vous avez fait pour Ribeauvillé et son aura.
Le mot du Président
A l’occasion du 80ème anniversaire de la libération de Ribeauvillé, le Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs a décidé d’éditer une nouvelle revue consacrée à l’histoire de la guerre 1939-1945 en contribuant modestement à l’œuvre de mémoire nationale pour que l’on n’oublie pas.
En son temps, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Ribeauvillé, puis le Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs ont eu à cœur de préserver les faits en retraçant la douloureuse histoire de notre cité administrée par les autorités nazies. Les historiens locaux de l’époque ont recueilli de nombreux témoignages des personnes ayant subi cette guerre qui a profondément bouleversé leur vie quotidienne et marqué durablement les esprits de toutes les générations d’Alsaciens, de Mosellans et de Ribeauvillois. Ces revues ont été très vite épuisées.
Aussi cette nouvelle revue reprend-elle les textes et témoignages parus dans nos publications antérieures en les complétant, les affinant et en précisant les faits historiques de cette époque trouble à la lumière des nouvelles données. En effet, le temps passant, les archives officielles et familiales s’ouvrent, le développement des archives sur Internet permet d’enrichir notre connaissance et de documenter plus largement cette période de l’histoire de notre cité. C’est donc une revue aussi complète que possible, comportant de nombreuses photos inédites et plus de 150 témoignages que le Cercle est fier de présenter. Nous sommes très probablement passés à côté de certains faits, nous n’avons pas eu connaissance de tous les témoignages. Que les oubliés nous excusent et qu’ils ne laissent pas leurs souvenirs disparaitre.
L’Alsace et la Moselle annexées ont payé un lourd tribu … C’est ce que nous avons tenté de montrer à l’échelle ribeauvilloise, même si cette étude n’a pas la prétention d’être exhaustive ; mais peut-on l’être en cette occurrence ? le sujet est trop vaste et comporte encore des zones sombres qui ne peuvent pas être dévoilées. Nous nous sommes efforcés de préserver et de diffuser le maximum de témoignages de ceux qui ont vécu le conflit - pendant qu’il est encore temps - et de les replacer dans leur contexte. Ne jugeons pas ces femmes et ces hommes, mais demandons-nous ce que nous aurions fait à leur place …
On verra dans cette revue que les années 1939/1945 n’ont pas été - comme on le pense trop souvent - un long fleuve tranquille pour notre cité et pour les Ribeauvillois. Nous avons pu (ré)étudier plusieurs aspects de cette sombre période, allant de l’accueil de plusieurs centaines de familles, en septembre 1939, dans le cadre de la Sitzkrieg (« guerre assis », terme allemand plus exacte que « Drôle de
de guerre », oxymore très déplacé !) qui n’a pas été - comme se sont plu à le répéter nos politiciens - une déroute !
Des chapitres sont consacrés à l’entrée des troupes allemandes, la mainmise nazie sur l’administration civile, les privations, l’incorporation de force des 297 jeunes Ribeauvillois dans la Wehrmacht ou la Waffen SS, les déportations, l’embrigadement de la jeunesse …
Et, bien sûr, une large place est consacrée aux dernières heures du conflit dans la région de Ribeauvillé et à la libération de notre cité avec ses aspects festifs, mais aussi de nouvelles heures sombres …
Un grand merci à tous ceux qui ont inlassablement exploré les coulisses de cette dramatique période dont la mémoire tend à s’estomper parce que les « anciens » ne sont plus là pour authentifier les faits. Cette revue a été réalisée par une équipe du Cercle qui a collecté des informations, souvent inédites, traduit les documents, collecté les photos, rédigé et mis en page. Un grand merci également à notre archiviste local qui a exhumé nombre de documents inédits qui ont permis de mieux cerner le vécu de nos parents et grands-parents.
Notre but est de raviver cette page d’histoire afin que les jeunes générations n’oublient pas ce que leurs aïeux ont enduré.
L’histoire peut être un système d’alerte des conséquences politiques induites, dès lors que les principes humanistes sont bafoués. Il nous paraît important de perpétuer le souvenir des tragédies passées et éviter qu’elles ne tombent dans l’oubli.
Bernard Schwach
Encore deux Ribeauvillois célèbres !
Eh oui ! encore deux célébrités ribeauvilloises qui prouvent, une fois de plus, que Ribeauvillé est bien au centre de l’Univers (n’en déplaise à Salvador Dali !).
Quelle a été notre surprise en découvrant dans le numéro 25 de 2013 de l’Annuaire de la Société d’Histoire de la Hardt et du Ried l’article de Violette Gross consacré au Pionnier du ski français Charles Diebold (1897 – 1987). En voici quelques extraits.
Il est le fils de François, Antoine, Charles Diebold, maître-boulanger né à Kleingoeft et d’Albertine Fender, née à Ribeauvillé. En 1902 la famille Diebold s’installe dans cette ville et tient une boulangerie au 22, rue des Tanneurs. Charles y fréquente l’école primaire avant d’entrer en apprentissage à Colmar comme employé de banque.
Au cours de la première guerre mondiale, enrôlé dans l’armée allemande, il sert sur le front russe où il découvre le ski. A son retour, il achète une paire de skis et, en 1925, parallèlement à sa profession, il enseigne le ski au Lac Blanc, à la Schlucht et au Markstein. Il est adepte de la Méthode de Ski de l’Arlberg (dont le point central est la posture du skieur : les genoux fléchis et le poids du corps dirigé vers l’avant. Cette position permet d’augmenter la vitesse et offre une plus grande maîtrise des virages, notamment grâce à l'utilisation du virage en chasse-neige). (…)
En 1932, il découvre le petit village savoyard de Val d’Isère. C’est le coup de foudre : « Fabuleux, j’étais sidéré, pris à la gorge. Quelle sensation ! » Pour la première fois, en 1934, l’Hôtel Parisien accueille des clients en hiver ! Cette même année, Charles Diebold choisit l’aigle blanc comme emblème de la station.
Il est à l’origine de nombreuses créations qui font, aujourd’hui la « routine » du ski français : Ecole Française du Ski en 1936, Grand Prix de Printemps (qui deviendra en 1955 le Critérium de la Première Neige), Chamois de France en 1938. Cette même année, il crée l’emblème de la station : un aigle blanc. Léo Lagrange, sous-secrétaire d’Etat aux Sports et aux Loisirs, lui demande d’ouvrir 74 centres de formation et de créer une technique française de ski.
En 1939 il est mobilisé dans l’artillerie lourde puis rejoindra le 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Après maints périples, il est fait prisonnier par les Allemands, contracte la dysenterie dont il est soigné à La Rochelle, avant de déserter, lors d’un transfert à Limoges, pour rejoindre sa femme à Grenoble. Après un court séjour à Megève en 1941, où il relance l’Ecole Nationale de Ski en s’occupant d’une centaine de moniteurs, il s’établit définitivement à Val d’Isère où il sera directeur de la station jusqu'en 1970.
Il y attire d’autres Alsaciens, comme le Dr. Petry, qui ouvre un cabinet médical, Fred Matter, cinéaste et explorateur, Alfred Feldmann, futur secrétaire de mairie, sans oublier les Killy, les parents de Jean Claude, devenu triple champion olympique lors des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, grâce aux bons conseils de son moniteur d’enfance, Charles Diebold.
Durant cette belle période, il est secondé par son épouse, secrétaire du Club des Sports. Tous deux furent pendant trente ans de précieux collaborateurs, tant à la direction de la station qu’au comité de direction du Syndicat d’initiatives et au Club des Sports. Ils sont les artisans consciencieux et intègres du succès de Val d’Isère, qui leur doit une très grande part de sa réussite.
Au décès de sa femme en 1980 à Val d’Isère, Charles Diebold, très affecté, découragé et sans descendance, revient en Alsace (à Ammerschwihr) et décède à l’hôpital de Kaysersberg en 1987 à 90 ans. Il est inhumé, aux côtés de son épouse, dans le cimetière de Val d’Isère.
Reconnaissante, Val d’Isère n’a pas oublié qu’elle doit à Charles Diebold une grande partie de son essor. Elle l’a l’honoré par la pose d'une plaque sur sa pierre tombale et par l’élévation d'une stèle à son nom le Front de Neige.
N.D.L.R. : vous en saurez plus sur Charles Diebold et son apport au ski français dans un prochain numéro de Bien vivre à Ribeauvillé.
Une Ribeauvilloise première dame du Chili dans la première moitié du XXe siècle !
Un article du journal l’Alsace du 4 janvier 1962 - déniché par l’archiviste de la ville, Benoît Moreau - nous révèle cette nouvelle célébrité Ribeauvilloise.
Le dentiste de notre cité, Emile Schaeffer (décédé en 1944), qui habite rue Salzmann, dans la belle maison du XVIe à l’angle de la rue des frères Mertian, a quatre enfants, dont une fille, Louise. Celle-ci épouse en 1927 à Ribeauvillé le docteur Sotero Del Rio (1900-1969), chirurgien , universitaire , chercheur , homme d’affaires , dirigeant syndical et homme politique chilien. Celui-ci, ayant contracté la tuberculose, est soigné dans un sanatorium à Davos en Suisse, tout en y pratiquant temporairement sa profession. On ne connaît pas la raison de sa présence en Alsace ni les circonstances de sa rencontre avec Louise.
De retour au Chili, le docteur Del Rio occupe successivement plusieurs ministères : Protection sociale (1931/1932), Santé (1943/1946, 1952 et 1959/1961), Intérieur (1959/1964). Le Président Jorge Alessandri étant célibataire, c’est Louise Schaeffer qui occupe de facto les fonctions de Première Dame en raison de la position protocolaire de son mari.
Parallèlement, Louise Schaeffer se consacre à de nombreuses œuvres de bienfaisance : fondation d’un mouvement universel des mères en faveur de la paix et contre la guerre nucléaire (elle reçoit le soutien notamment de la Reine Elisabeth II, du Pandit Nehru, du Président Kennedy, de Nikita Khrouchtchev, …), œuvre de distribution de jouets aux enfants indigents, organisation de soutien à l’enfance (en liaison avec l’UNICEF), aide aux réfugiés, secours aux victimes du tremblement de terre de 1960, développement culturel (appuyée par l’UNESCO), …