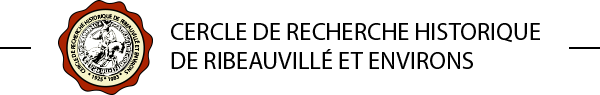~3eme trimestre 2022~
Le mot du Président
Chaque année après le Pfifferdaj, c’est la rentrée pour les membres actifs du Cercle qui vont poursuivre leurs investigations du passé de la Cité et partager avec le plus grand nombre le fruit de leurs recherches.
Depuis le mois de janvier 2022, date de la parution des précédentes Nouvelles du Cercle, les membres du comité ont planché sur l’histoire des écoles à Ribeauvillé. L’étude de cette thématique inédite a été tellement passionnante que la revue a battu les records de pagination, avec plus de 300 pages … et encore, il a fallu se limiter.
Mais nous avons encore glané dans les archives municipales de nombreuses perles cachées dans l’armoire du temps, de brèves nouvelles insolites qui vont sans doute vous passionner.
Bonne lecture.
Bernard Schwach
Un été particulièrement studieux !
Malgré la canicule l’été ne fut pas de tout repos ! Loin de là … L’équipe projet a terminé la rédaction de la revue n° 30 consacrée à l’histoire de six siècles d’écoles à Ribeauvillé : du Moyen-Âge à nos jours.
Vaste sujet s’il en est ! Il est copieux et mérite les quelques 330 pages de la revue. Notre cité a compté pas moins d’une quarantaine d’écoles tant publiques que confessionnelles (pendant longtemps, on ne mélangeait pas les enfants de religions différentes) et/ou privées, accueillant internes et externes, garçons et filles (le plus souvent séparés jusqu’à la fin du XIXe siècle au moins).
Cette étude est l’occasion d’aborder certains sujets de discussions, de réclamations, de contestations et de tensions récurrentes qui paraissent encore bien d’actualité : la rétribution des maîtres et instituteurs ; les effectifs des élèves dans les classes, la taille, l’aménagement et l’état des maisons d’école, la non assiduité (voulue ou imposée) des élèves, la turbulence des enfants, la qualité et le sérieux des maîtres, l’indépendance des maîtres vis-à-vis du pouvoir (religion, état, ville).
Le sujet fait également l’objet de l’exposition annuelle traditionnelle du Cercle qui présentera un nombre particulièrement important de photos de nos écoles, parmi lesquelles de très nombreuses photos de classe (450 !), réunies par Raymond Furhmann. On y trouvera aussi quelques objets qui ne manqueront pas de provoquer un peu de nostalgie ou … de mauvais souvenirs.
Résurrection du pèlerinage de Dusenbach lors du Pfifferdaj
Les anciennes traditions imposent aux ménétriers d’effectuer un pèlerinage à Notre Dame du Dusenbach. Cette tradition multiséculaire s’est arrêtée au lendemain de la Révolution française.
En 1953, arrive à Dusenbach Monseigneur Vogel, évêque d’origine alsacienne expulsé en 1952 de la Chine communiste où il a œuvré de 1931 à 1952 dans le diocèse de Swatow (sud de la Chine). Ce prélat, alors âgé de 75 ans, se retire à Dusenbach et s’intéresse à l’histoire locale. Informé de l’histoire des ménétriers, il souhaite renouer avec la tradition et propose de célébrer une messe le dimanche matin du Pfiff. Il invite toutes les sociétés de musique et de chant choral du secteur à se rendre à Dusenbach, pour y faire bénir les instruments de musique. L’engouement est tel que plus de 1500 fidèles montent en procession jusqu’au sanctuaire. La messe, concélébrée par Monseigneur Vogel et le Père Célestin Hatsch a été empreinte d’une magnificence qu’elle n’a pas connue depuis bien longtemps.
L’année suivante, c’est grâce à l’initiative de Guy Engelberger, président du groupement de Colmar-Ribeauvillé de la Fédération Catholique des Sociétés de Chants et de Musiques d’Alsace, que cette manifestation se pérennise. Monseigneur Weber, évêque de Strasbourg, soutient cette noble initiative et vient célébrer cette seconde messe qui est alors détachée de la fête principale et décalée au deuxième dimanche du mois de septembre.
Depuis cette date, le pèlerinage à Notre Dame du Dusenbach met un point final aux festivités de la fête des ménétriers.
Le cortège (composé d’élus en costume traditionnel, de différentes harmonies, des membres de la confrérie Maria Raydt

Pèlerinage du Dusenbach 2000
Confrérie Maria Raydt
portant la statue de la Vierge, ainsi que de nombreux fidèles costumés) part de la place de la Sinne pour se rendre à pied jusqu’au sanctuaire de Dusenbach. A leur arrivée, les Pères du pèlerinage accueillent sur le parvis cette foule de fidèles avant de les inviter à suivre une grand-messe toute particulière rehaussée par les chants d’une ou plusieurs chorales et la musique de diverses harmonies.

Pèlerinage du Dusenbach 2000
La Vogesia
En 1957, la grand-messe est célébrée par Monseigneur Charles Brand qui s’est dit attaché au Pfifferdaj, car sa maman, originaire de Ribeauvillé, participait déjà à cette fête. Il a d’ailleurs fait une partie de son sermon en alsacien, sur le thème de la fraternité des ménétriers.
Carnet du Cercle
Bienvenue à nos nouveaux membres : Steeve Baumert (Ribeauvillé), Virginie Boulard (Ribeauvillé), Véronique Hugel (Epernay), Bernard Kaess (Mundolsheim), Francis Klein (Hunawihr),
Petites Nouvelles de la recherche
Voici quelques extraits des délibérations du conseil municipal de la première moitié des années 1950, recueillis par Bernard Schwach.
- Acquisition de l’ancienne ferme du Acker, près de la Petite Verrerie: après l’incendie de la ferme Acker enclavée en pleine forêt communale, la parcelle d’une contenance de 498 ares est proposée à la municipalité le 5 novembre 1954. Les services de l’Etat estiment à 400000 F (soit, en valeur 2021, environ 9250 €) la valeur de ce bien. Mais le propriétaire en demande 500 000 F (soit, en valeur 2021, environ 11600 €). Finalement la municipalité se résout à payer cette somme pour l’acquisition de ce domaine. La baraque subsistante sera louée à M Paul Hueber pour un loyer annuel de 3000 F (soit, en valeur 2021, environ 70 €). L’année suivante la municipalité décide de reboiser les 5 ha de prés en 3 tranches annuelles, avec un budget de 200000 FRF par an (soit, en valeur 2021, environ 4600 €).

Ferme Acker
- Où la ville acquiert le Pfifferhus: en mai 1949, la veuve Eugène Sigrist, née Bentz, fait don à la ville du 14, Grand’rue, abritant le restaurant Pfifferhus. Mais elle gardera l’usufruit de son bien jusqu’à sa mort. Très vite il faut intervenir dans un bâtiment qui semble quelque peu « fatigué » dès décembre 1949 : remplacement, en urgence, de la charpente et du toit, ainsi que des cabinets d’aisance du restaurant. Ce don s’avère être un cadeau empoisonné. L’expertise du bâtiment par l’architecte communal révèle de nombreuses malfaçons et le devis de la remise en état se monte à 2,7 millions de francs (soit, en valeur 2021, environ 88000 €) ! Compte tenu de l’énormité de la somme, le conseil décide de réaliser les travaux en plusieurs tranches. Mais, finalement, la commune ne fera que des aménagements sommaires pour mettre le bâtiment en conformité aux normes sanitaires de l’époque. Quelques années plus tard elle vend le bâtiment et le fonds de commerce au gérant du restaurant, Meistermann.
- Bibliothèque municipale: en juillet 1951 M. Kuder, qui gère bénévolement la bibliothèque, fait part de son souhait de profiter de sa retraite. La municipalité cherche donc à le remplacer et sollicite les enseignants de l’école des garçons (où la bibliothèque est alors installée). Finalement c’est le directeur Holl qui accepte cette mission. Il sera dédommagé de 8 stères de bois débités.
- Construction d’un hangar communal: l’ancien hangar communal est situé entre le cimetière et la maison Ostermann, sur l’emplacement d’une ancienne tuilerie.
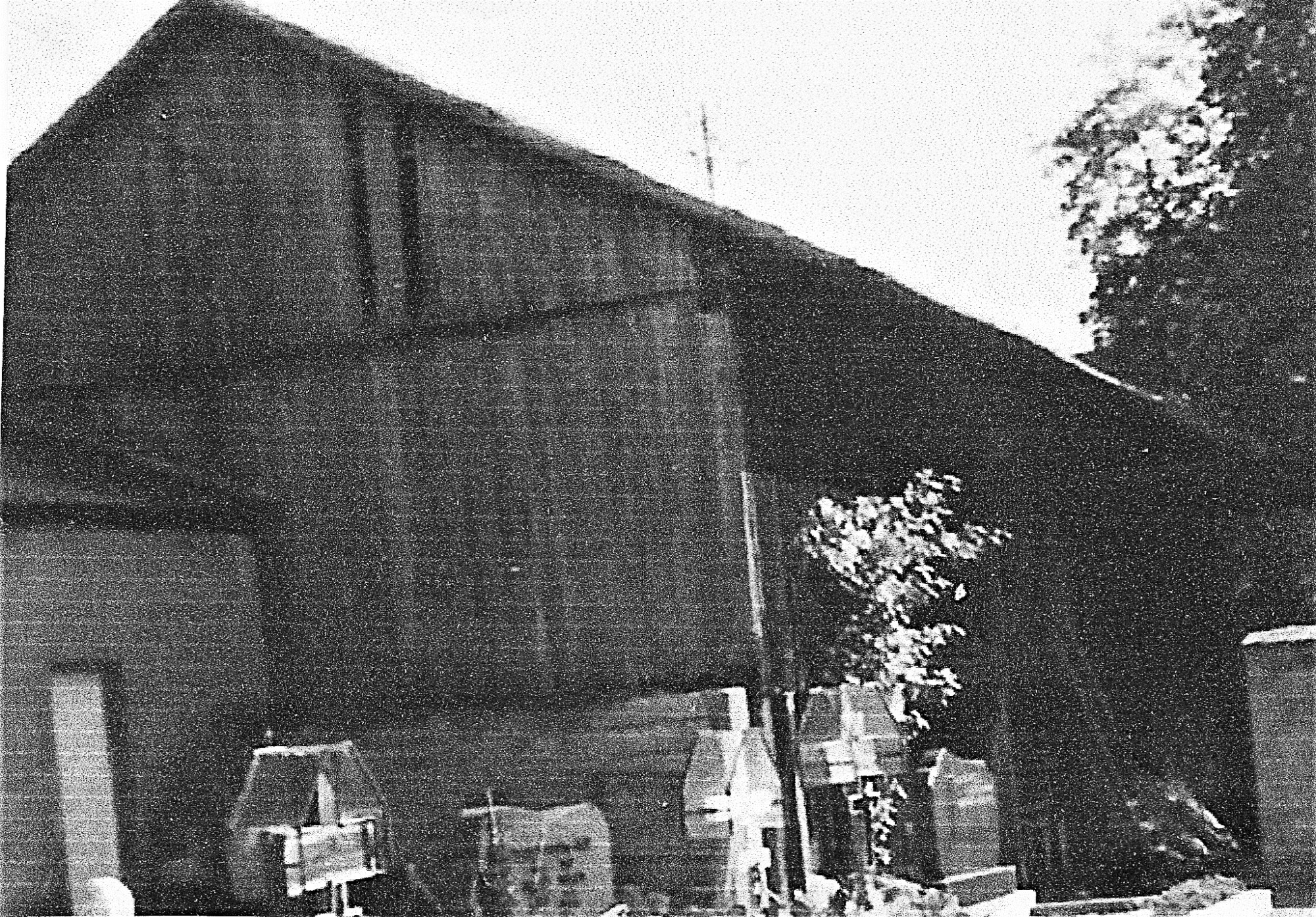
Ancien hangar municipal rue du cimetière (photos de 1962)
Estimant que ces locaux ne sont plus fonctionnels, la municipalité envisage de construire de nouveaux garages derrière la mairie. Les travaux devront être engagés rapidement et le devis estime le coût à 6 MF (soit, en valeur 2021, environ 137 000 €). L’adjoint Kugler propose même de déplacer le Monument aux Morts à la place de l’ancien hangar communal. Mais entretemps, en mai 1952, le négociant en métaux, Louis Faller, propose de vendre à la commune l’une de ses propriétés située 3a route de Guémar qui comprend un ensemble immobilier avec maison d’habitation, ateliers et hangars, répartis sur 14,45 ares. Cette propriété pourrait servir à l’installation des services de la voirie municipale.
Ancien hangar municipal route de Guémar
Le prix négocié sera de 4,35 MF (soit, en valeur 2021, environ 99 000 €). Les bâtiments ont été été construits en 1841 par le voiturier Michel Wymann. Ils sont agrandis avec la création d’ateliers en 1892 par le charpentier Georges Sieffert. En 1934, la propriété passe aux mains de la famille Wasser, l’un des premiers entrepreneurs de transports par camion de la ville. Au lendemain de la guerre, Louis Faller acquiert l’ensemble. Le Conseil Municipal discute de l’opportunité de cet achat et décide, compte tenu de l’urgence, de renoncer à l’exécution de la construction du hangar communal près de la mairie. Le déménagement a été effectué durant l’été 1952 et l’ancien hangar a été loué au Centre de Recherches Agronomiques d’Alsace (futur INRA) avec un loyer mensuel de 1200 F (soit, en valeur 2021, environ 27 €). - Tension au sein de l’Harmonie Municipale: Eugène Bréfie, chef de l’Harmonie Municipale et fonctionnaire communal, donne sa démission en août 1952 suite au refus du maire de l’engager à temps partiel comme dirigeant de l’Harmonie. L’adjoint au maire et président de l’Harmonie, Kugler, demande à la municipalité d’engager un nouveau directeur, sans quoi la musique de Ribeauvillé risque de disparaître : Ribeauvillé se doit de posséder une musique municipale, ne serait-ce que pour rester dans la tradition de notre Cité des Ménétriers. Il insiste sur une solution d’urgence, car c’est, d’une part dans l’intérêt du maintien de cette belle Société, qui sans se vanter compte parmi les meilleures de la région et, d’autre part, parce qu’elle est engagée pour le prochain Pfifferdaj et pour le concert d’été ». L’adjoint annonce qu’il a pris contact avec un professeur de musique de Colmar, René Engler, qui est disposé à assumer la fonction de directeur. Kugler met sa démission dans la balance. Finalement le maire décide que le Chef sera engagé par l’Harmonie Municipale, mais que la commune paiera à la Société les frais sous forme de subventions supplémentaires globales.
- Demande de transfert du marché hebdomadaire: en novembre 1952, l’Association des Commerçants de Ribeauvillé contacte la municipalité pour engager une discussion concernant le transfert d’une partie du marché hebdomadaire vers la place de la Sinne. Après discussion, une partie des conseillers s’oppose à ce déplacement vers une place qui est déjà encombrée. La même demande est reformulée officiellement en avril 1955. Quelques commerçants adressent une pétition à la mairie pour demander le transfert du marché des étoffes vers la place de la Sinne pour ranimer le commerce local de la Haute Ville.
- Subvention aux Transports Schlachter: en juin 1952, le transporteur Henri Schlachter invoque le fait que sa ligne d’autobus reliant Ribeauvillé-ville à Ribeauvillé-gare est déficitaire de 1 MF pour l’exercice 1951 (soit, en valeur 2021, environ 25600 €). Afin de pérenniser cette ligne il souhaite obtenir une subvention de 88000 F par mois (soit, en valeur 2021, environ 2000 €) pour couvrir le manque à gagner. La municipalité accepte le principe de subventionner la ligne, mais demande aux autorités départementales de vérifier l’opportunité des montants à allouer. En octobre 1952, la municipalité contacte l’entrepreneur pour lui signifier que la commune serait prête à lui accorder une subvention mensuelle de 50 000 F (soit, en valeur 2021, environ 1100 €). Mais l’autocariste maintient son exigence et menace de ne plus desservir la ligne. Le conseil municipal débat à nouveau de ce problème et argumente que la nouvelle ligne accordée pour desservir Colmar est largement excédentaire et passe déjà à la gare de Ribeauvillé ; la ville a mis à la disposition de la compagnie les locaux de l’ancien tramway à des conditions très avantageuses et elle est déjà subventionnée à raison de 120000 F par an (soit, en valeur 2021, environ 2700 €) pour vendre les billets de la SNCF, service qui laisse d’ailleurs beaucoup à désirer. La municipalité menace d’évincer les autocars Schlachter des bâtiments qu’ils occupent et de confier le service officiel à l’entreprise Pfeiffer de Bergheim.

Voyages de l’Hirondelle de Henri Schlachter
- Pétition des usagers des cars Schlachter: le 1er avril 1955 le conseil examine une demande de plusieurs usagers des transports Schlachter, assurant la liaison avec Colmar, qui souhaitent que le service des bus soit prolongé jusqu’à la place de la République. Le maire est plutôt réservé, arguant que la Grand’rue est étroite et à double sens, ce qui occasionnerait des difficultés supplémentaires dans la circulation du centre-ville. Mais finalement on trouve un consensus : à titre d’essais on autorise la circulation d’un bus le matin et le soir.
- Entrave à la libre circulation des personnes : en avril 1955, le maire évoque le problème de l’entrave à la circulation causée par les commerçants qui installent de plus en plus « d’objets-réclames » sur les trottoirs, voire sur la chaussée. Le Conseil charge le maire d’écrire à tous les commerçants qu’ils seront dorénavant responsables en cas d’accidents causés par la présence d’obstacles sur les trottoirs. En réponse, les commerçants adressent une pétition signalant que les pavés de la Grand’rue sont en très mauvais état et qu’ils se plieront aux diktats de la municipalité dès lors que la rue sera correctement entretenue. Le maire contacte alors le service des Ponts et Chaussées qui se disent prêts à rénover la voirie sous réserve d’une participation financière de la commune. Le Conseil se montre plutôt réservé quant à cette proposition. Dans l’urgence les services de l’Etat réparent à minima la chaussée en égalisant les enfoncements par des plaques de macadam. Les anciens se souviennent encore de ces sparadraps bitumés qui étaient censés cacher la misère de la chaussée.
- Demande de classement de la ville en Station Hydrominérale: le 10 septembre 1954, la municipalité examine une suggestion de la préfecture au sujet d’un éventuel classement de la commune en Station Hydrominérale, compte tenu de la présence historique des sources Carola. Ce classement permettrait de percevoir des taxes de séjour sur le prix des nuitées passées à Ribeauvillé. Les autorités avancent un revenu de 850 000 F par an (soit, en valeur 2021, environ 16900 €). Les conseillers, à l’unanimité, demandent au maire de dresser un dossier en ce sens. Ils tirent même des plans sur la comète et proposent d’affecter ces sommes aux travaux d’assainissement et d’embellissement de la ville. Mais les espoirs furent rapidement déçus, car les critères d’éligibilité au classement semblaient trop contraignants. Ainsi il aurait fallu créer une Chambre d’Industrie Thermale pour la seule Cité des Ménétriers. Ribeauvillé ne pourra se flatter d’être « une ville d’eaux », à l’instar de Vittel ou Contrexéville.
- Création d’un syndicat intercommunal de ramassage des ordures: en janvier 1955, les maires de six communes du canton se réunissent pour décider de la création d’un syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures et le nettoiement de la voirie. Il s’agit des communes de Bennwihr, Bergheim, Hunawihr, Ostheim, Ribeauvillé et Riquewihr. Le siège de ce syndicat sera fixé à la mairie de Ribeauvillé.
- Redevances pour les pompes à essence occupant l’espace public: en avril 1955, le maire adresse un courrier aux trois garagistes (Lucchini, Bebon et Horny) pour leur signaler que, dorénavant, il faudra payer une taxe de 200 F (soit, en valeur 2021, environ 4,6 €) par pompe à essence.

~1er trimestre 2022~
Quand le seigneur se mêlait d’éducation
Des membres de notre Association mènent actuellement des recherches sur le sujet de la revue 2022 : l’histoire de l’école à Ribeauvillé. En voici un petit aperçu particulièrement instructif !
En 1722, le Conseil du comte Birkenfeld-Deux Ponts promulgue le seul règlement resté dans les archives ; en voici de larges extraits :
1) Chaque maître doit toujours se référer à ses supérieurs, ecclésiastiques ou temporels, les respecter, leur obéir et suivre scrupuleusement leurs instructions, pour tout ce qui concerne l’information sur la vraie foi catholique, les bonnes mœurs, les connaissances en lecture et en écriture nécessaires à la jeunesse.
2) Dans sa vie privée et surtout en présence des élèves, le maître doit mener, en toutes choses, une vie vertueuse, respectable, pieuse et irréprochable, avoir une conduite édifiante, éviter tout scandale et montrer le bon exemple à la jeunesse. En cas de désobéissance, de paresse ou de méfait, il ne doit pas punir ses élèves dans un accès de colère ou d’impatience, ni les frapper de ses poings ou leur tirer les cheveux, encore moins leur taper sur la tête, mais utiliser la verge sans excès und mit Maniére[1] (et s’il y a des filles, les séparer des garçons).
3) Le maître doit faire en sorte que tous ses élèves viennent en classe, été comme hiver, le matin de sept heures à dix heures et l’après-midi de midi à trois heures et qu’ils y restent le temps voulu, qu’ils s’appliquent à faire leur prière et à chanter les cantiques avec recueillement. On ne doit pas leur permettre d’aller et de venir pendant les cours, afin qu’ils ne perdent rien de ce qui est enseigné. Si les excuses invoquées ne sont pas valables, l’élève doit être puni par des coups de baguettes ou d’une autre manière ; les plus jeunes devront néanmoins bénéficier d’une certaine mansuétude.
4) Lorsque les enfants sont rassemblés, chacun doit reciter avec ferveur, avant et après la classe, la prière apprise jour après jour (…). Il veillera à ce que ses éleves soient appliqués ; il interrogera les débutants en lecture deux fois par jour. Il enseignera et contrôlera l’orthographe aussi souvent que nécessaire ; chaque jour, l'élève fera ses lignes avec soin. Après la classe, le maître consignera le travail effectué au cours de la journée et du mois ; avec pour preuve sa signature, ce qui évitera les plaintes.
5) Si le maître ou ses remplaçants envisagent de faire lire aux éleves un livre ou une brochure, qu’i1s soient de nature spirituelle on profane, l’ouvrage devra être vu et approuvé auparavant par le curé concerné.
6) Le maître devra veiller aussi à ce que ses éleves, qu’ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, de la cité ou des environs, ne portent rien d’inconvenant, qu’ils n’échangent pas de cadeaux, qu’ils ne fassent ni troc ni commerce d’argent. Il fera attention à ce qu’ils ne se moquent pas les uns des autres, qu’ils ne se méprisent pas, qu’ils ne se battent pas, qu’ils jouent sans tricher, comme cela pourrait arriver.
A l'école, les garçons respecteront le maître tout comme à la maison, tout comme à l'église, dans la rue, ils témoigneront de la déférence à leurs parents, aux prêtres, aux personnes âgées, hommes ou femmes.
A la sortie de l’école et dans la rue en général, ils éviteront de crier, de courir et de se livrer à tout comportement obscène.
Le maître surveillera livres et chants afin qu’aucun écrit hérétique, suspect, obscène, coquin ou fâcheux ne tombe entre leurs mains. Il s’efforcera non seulement de faire progresser leurs connaissances, mais les fera grandir aussi sur le plan moral, dans la discipline et l’honneur. Ceux qui se rendront coupables de mauvaise conduite, devront être punis comme il se doit et s’il se trouve l’un ou l’autre récalcitrant, qui, contre tout espoir, persévère dans ses mauvaises mœurs et ses vices, on le signalera aux autorités, afin qu’il soit exclu de l’école, telle une brebis galeuse qu’on isolerait du troupeau.
Tout élève, grand ou petit, qui entre en classe, ôtera son chapeau avec respect en guise de salut. (…)
7) Pour son enseignement conforme et son travail consciencieux, le maître recevra le traitement mérité, selon les usages en vigueur dans chaque commune (…)
8) A Pâques, à la Pentecôte, à Noël et à l’occasion des autres fêtes de l’année, les enfants n’auront pas d’autres vacances que les jours fériés en question. Le Jour des Morts et le Mercredi des Cendres ils n’iront en classe que l’après-midi.
Les maîtres ne donneront pas trop de vacances, ni à Carnaval ni pendant la canicule.
- Durant les semaines comportant un jour férié, il y aura deux heures de classe l’après-midi, hormis le jeudi après-midi (…).
Vous avez dit « réchauffement » ?
L’Histoire a conservé les dates des hivers particulièrement rigoureux qui ont eu des répercussions sur la vie politique, sociale et économique de notre région. Les archives du Cercle conservent un document donné par Adeline et Lucienne Hauser en octobre 2009. Il s’agit d’un volume (année 1889) rassemblant plusieurs numéros de la revue bilingue Der Wanderer im Elsass - Le Touriste en Alsace qui a paru quelques temps à parti de mars 1888.
On y trouve un relevé des périodes de froid les plus marquantes telles que relevées dans les archives de divers monastères notamment celles des dominicains de Colmar.
356 : en janvier, froid particulièrement vif ; le Rhin gèle, les « barbares » germaniques de Clodomaire en profitent pour traverser le fleuve à « pied sec » et s’emparer de Strasbourg ainsi que de la forteresse romaine, Augusta Tribocorum (Brumath).
566 : hiver particulièrement long ; neige abondante pendant plusieurs mois. L’intensité du froid fait périr hommes et animaux.
608 : l’hiver est tellement froid que la plupart des vignes sont gelées et détruites.
763 : autre hiver terrible par sa durée du 1er octobre jusqu’à la fin février.
764 : de nouveau un hiver particulièrement rude, les oiseaux tombent morts sur la terre et certains sont gelés dans leurs nids en couvant.
780 : froid terrible.
821 : hiver précoce (novembre) avec un froid très vif. Toutes les rivières sont gelées, les chariots lourdement chargés peuvent traverser en toute sécurité.
824 : la neige couvre la terre dès septembre pour 29 semaines provoquant la mort de nombreuses personnes et animaux.
832 : hiver extraordinaire.
860 : gelée et neige de novembre à avril 861. Toutes les rivières sont gelées.
880 : hiver très long et très froid. Le Rhin est gelé plus de 2 mois ; on le passe à pied, à cheval ou en voiture.
964 : froid du 15 novembre jusqu’au-delà du mois de mai (dernière gelée le 12 juillet).
975 : hiver très long et très rigoureux. Hommes et bestiaux souffrent de la grande quantité de neige tombée en décembre et en janvier.
988 : la rigueur du froid détruit toutes les semailles.
1063 : mi-avril, froid intense accompagné de vent et de neige, faisant périr animaux et oiseaux et geler les vignes.
1074 : les rivières gèlent jusqu’au fond.
1076 : neige abondante suivie d’un froid intense.
1100 : arbres et ressources gèlent entraînant une profonde misère.
1124 : hiver particulièrement rigoureux avec alternances de pluie, de gelée et de neige de décembre à février. Nombre de femmes et d’enfants succombent au froid.
1126 : tous les produits de la terre sont détruits par le froid, d’où une disette faisant mourir de faim plusieurs milliers de personnes. Les animaux domestiques s’entredévorent.
1188 : épisode de froid soudain en mai et juin.
1204 : les rivières sont gelées et le froid est le rigoureux de mémoire d’habitants.
1223 : hiver long et rigoureux détruisant les semailles entrainant, l’été suivant, une grande disette.
1224 : hiver très long d’octobre à la fin avril.
1268 : le froid dura jusqu’à la Saint Urbain (25 mai) et il n’y a donc pas de récolte de vin.
1272 : froid particulièrement intense à Ribeauvillé, le Saint Sacrement gela à Noël.
1278 : de nouveau des gelées jusqu’à la Saint Urbain, les vignes sont toutes gelées.
1279 : 19 mai, gelées frappant tous les arbres fruitiers.
1288 : en mars, le Rhin gèle en deçà de Bâle. Le vin gèle dans les calices et dans les vases.
1292 : froid particulièrement vif à la Chandeleur faisant geler le Rhin que l’on peut traverser avec des charrois.
1294 : froid intense le 17 février, les arbres se fendent, les poissons gèlent dans les eaux et bon nombre de gens périssent de froid.
1297 : hiver particulièrement doux ; des roses fleurissent dans le jardin du couvent des dominicains à Colmar.
1303 : froid vif en février entraînant la mort de nombreuses personnes.
1334 : gel des vignes.
1363 : gel du Rhin en décembre, la glace peut supporter des poids « des plus considérables ». Dans beaucoup d’endroits, la glace perdure jusqu’à la Pentecôte.
1364 : hiver cité comme un des plus rude. Le froid fend les arbres par le milieu.
1407-1408 : grand hiver. Le froid dure 12 semaines, le Rhin est gelé de Strasbourg à Cologne (que l’on peut relier en charrois). Le vin gèle dans les caves.
1442 : froid violent de la Sainte Catherine (25 novembre) jusqu’en avril.
1476 : le Rhin gèle fortement en décembre. Au siège de Nancy, 400 hommes de l’armée de Charles le Téméraire moururent de froid la nuit de Noël.
1513 : tous les fleuves européens sont pris par la glace.
1554 : le Rhin est gelé durant deux mois à Strasbourg.
1565 : abondance de neige à Strasbourg ; on relève 7 pieds de hauteur (environ 2,5 m !)
1598 : froid intense faisant geler le vin dans les caves et doit être coupé en morceaux à la hache pour la vente !
1603 : à Noël il fait aussi chaud qu’en été.
1607-1608 : jour de l’an le plus rigoureux de mémoire d’homme. Beaucoup de gens meurent de froid. Un individu, venant de Sainte-Marie-aux-Mines, arrive mort sur son cheval à Ribeauvillé. A Colmar le vin gèle dans les caves et fait éclater les tonneaux.
1784 : en janvier, en une journée, il tombe plus de quatre pieds de neige (1,2 m)
1789 : hiver le plus rigoureux du siècle. Soixante jours le froid fut intense suivis d’un épisode neigeux important (20 pieds (6 m) par endroit). De nombreuses maisons sont emportées par des avalanches dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Un grand nombre de personnes périssent de froid, de faim ou de misère. Cet épisode hivernal douloureux fut l’une des causes de la Révolution française.
Règlements de police de la seigneurie en 1720
« Le nouveau règlement de police, édictée ce jour, sera lu en lieu public, avec prestation de serment de tous les sujets.
Il est interdit, sous peine d’une amende de 5 florins, d’héberger plus de 24 heures toute personne étrangère à la Seigneurie qui n’aurait pas sollicité auparavant accueil et protection auprès de la chancellerie.
Toute personne désirant quitter la Seigneurie pour s’établir ailleurs doit être libre de toute dette.
Quiconque se permet de traiter son semblable d’adultère, de meurtrier, de Guckguck[2], de voleur, de brigand, de loqueteux, de vaurien, fripon ou menteur et s’il se met à jurer en disant « que le diable t’emporte » ou que « la grêle te terrasse », sera passible d’une amende de 2 florins.
Pour que des mots tels que rustre, nigaud, grossier personnage, fanfaron, l’amende sera limitée à 1 florin.
Ces amendes seront aussi infligées aux femmes pour injures et outrages, lorsqu’elles se prennent par les cheveux, qu’elles se griffent et se donnent des coups. Elles seront tenues à des excuses publiques. Il en sera de même pour quiconque aura, lors d’un différend, griffé, frappé, pincé, déchiré des habits ou mordu. Si une telle personne a mordu jusqu’à couper un doigt en deux, elle paiera en plus pour le barbier (le chirurgien).
Celui qui frappe son prochain avec ses poings, un gourdin, un bâton ou tout autre instrument provoquant des bleus, mais ne frappant pas à sang, qui le roue de coups de pied et le jette au bas d’un escalier, est passible d’une amende de 3 florins. S’il y a coup de couteau, le coupable sera mis au cachot, au pain et à l'eau.
Tout sujet rencontré, après 9 heures en hiver et 10 heures en été, en train de se disputer, de crier et faire du tapage dans les rues paiera 3 florins. Celui qui tire le couteau ou l’épée paiera 5 florins de même que celui qui fait feu sur quelqu’un paiera 10 florins. Pour avoir pêché dans les étangs et ruisseaux, la sanction sera une amende ou le carcan.
Aux débitants de vin et de bière, il est interdit de tolérer que des bourgeois, manants, jeunes gens ou compagnons s’attardent dans leur établissement au-delà de 10 heures du soir. Sous peine d’une amende de 10 florins, ils sont tenus de veiller à ce que leurs clients quittent leur débit à l’heure indiquée.
Tout projet de construction, que ce soit maison d’habitation, grange ou écurie, doit être soumis, avant sa réalisation, aux autorités.
L’alignement des bâtiments le long de la rue doit être respecté. Le droit d’égout et de vue ne doit pas être entravé. Les cheminées doivent être de bonne qualité et aucune toiture ne sera couverte de chaume.
Il est strictement interdit de fumer le tabac dans les granges et les écuries, et tout lieu où l’on travaille le chanvre et le lin.
Les tas de fumier sont interdits devant les maisons. Tout contrevenant est soumis à une amende de 3 florins. »
*********
[1] Sans excès et avec manière (Voici un bel exemple du mélange de langues pratiquées en Alsace, français, alsacien, allemand !!!).
[2] Voyeur.